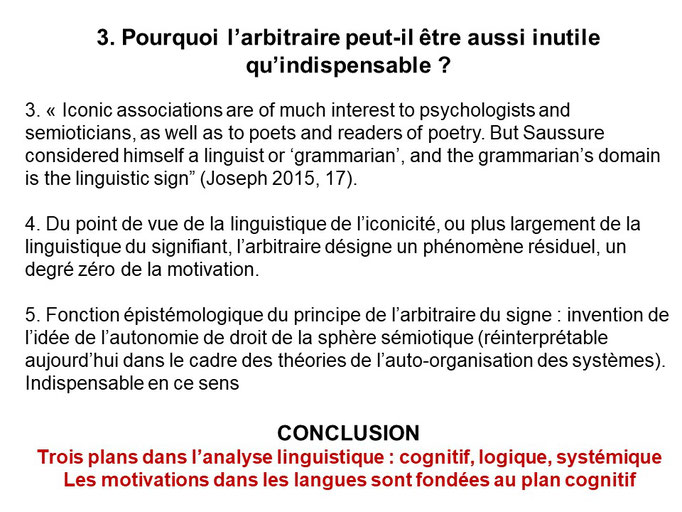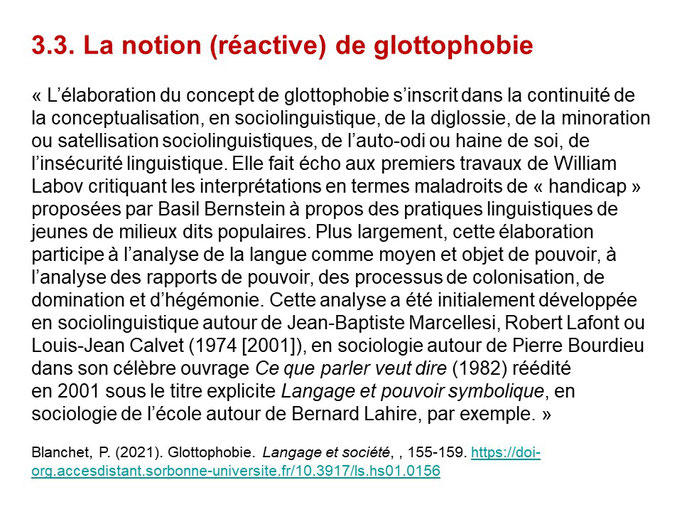Reprise des cours / Année 2024/2025

Les cours de l'année universitaire 2024-2025 commenceront le 16 septembre pour les Licences et le 23 septembre pour les Masters.

Reprise des cours / Année 2023/2024
Les cours de l'année universitaire 2023-2024 commenceront le 18 septembre pour les Licences et le 25 septembre pour les Masters. Mais le cours "Signification et théories linguistiques" commencera le 26 septembre.

Enseigner la grammaire pour développer les compétences métalinguistiques : l’élaboration de la Terminologie grammaticale de 2020 en France.

L’élaboration d’une terminologie grammaticale à usage scolaire requiert la prise en compte de facteurs non seulement épistémologiques, linguistiques et didactiques, mais aussi une attention aux usages en milieu scolaire. L’ensemble des termes grammaticaux qui font l’objet d’un enseignement explicite dans les écoles, les collèges et lycées présente en effet, à quelques détails près, une stabilité indéniable, au moins depuis la nomenclature grammaticale de 1975. Cette stabilité est souhaitable (et elle révèle une forme de maturité de la connaissance linguistique) mais elle limite drastiquement les changements qui peuvent être apportés à la terminologie grammaticale sans déstabilisation des pratiques scolaires. Toutefois, on le sait bien, le problème majeur auquel sont confrontés les élèves et les professeur(e)s ne réside pas tant dans les termes eux-mêmes que dans le flou de leur référent. Les deux questions doivent donc être clairement distinguées : le choix des termes d’une part, la stabilisation de leur contenu conceptuel d’autre part. Dans cet article, on défend l’idée qu’il est nécessaire de fournir aux élèves un appareil conceptuel stable qui leur permette de décrire un ensemble limité d’énoncés. Le problème n’est donc plus de proposer des définitions ou des critériologies complètes qui s’appliquent à toute occurrence du terme, mais des définitions (et des critères) qui conviennent à une classe finie d’occurrences du terme, constituée par ses emplois prototypiques. En d’autres termes, l’essentiel consiste à disposer d’un appareil conceptuel présentant une systématicité suffisante pour être perceptible par les enseignant(e)s et par les élèves. C’est dans cette perspective qu’est exposée la démarche d’élaboration de la Terminologie de 2020. L’idée directrice de cette Terminologie est donc de proposer un appareil conceptuel provisoire, à usage scolaire, qui puisse servir de base pour l’analyse critique et l’entrée dans une véritable démarche réflexive.
Accéder au texte sur le site du Français moderne
Cognitive Linguistics and a usage-based approach to the study of semantics and pragmatics

Dans ce handbook, on trouvera un chapitre intitulé, "Cognitive Linguistics and a usage-based approach to the study of semantics and pragmatics" rédigé par Guillaume Desagulier et Philippe Monneret
Pour une autonomie radicale de l’enseignement grammatical : une argumentation phénoménologique

Si le discours grammatical est envisagé comme appartenant à la catégorie générale du « discours sur la langue », il conviendra, à un stade ou un autre de la réflexion sur l’enseignement de la grammaire, d’interroger cette catégorie générale. Or, en dépit de son apparente clarté, la notion de « discours sur la langue » présente au moins deux caractéristiques paradoxales.
Prolégomènes à une linguistique théorique
Journée Masteriale, « Approches linguistico-discursives en sciences du langage », Université de Picardie Jules Vernes, 14 juin 2023.

L’approche psychomécanique du nombre linguistique

On retient généralement de la théorisation guillaumienne de la catégorie du nombre l’idée que le système du nombre est fondé sur une double tension faisant alterner un mouvement de particularisation aboutissant au singulier et livrant un ou plusieurs pluriels internes (duel, triel, etc.) et un mouvement de généralisation aboutissant à la pluralité externe, c’est-à-dire au pluriel dans son sens ordinaire. Il est également notoire que, pour Gustave Guillaume, le système de l’article est obtenu par une sorte de dérivation à partir du système du nombre, en ce que le système de l’article retient la double tension particularisante puis généralisante, mais sans retenir l’idée de nombre (voir par exemple Carvalho 2007, Neveu 2009).

« Présentation du guide La Grammaire du français du CP à la 6e (2022) »
Programme national de formation. Plan français – session n°17. "Écriture et lecture, écriture et grammaire : articuler l’écriture avec les autres domaines du français", 4 avril 2023, en visioconférence
La grammaire du français du CP à la 6e

La Grammaire du français, Tome II, parue en 2022, fait suite au volume Grammaire du français. Tome I. Terminologie grammaticale publié en juillet 2020 par la Direction générale de l’enseignement scolaire.
L’objectif du premier tome était de stabiliser une terminologie fiable, partagée depuis le cycle 2 jusqu’aux classes du lycée, instrument indispensable d’un enseignement progressif, harmonisé et efficace de la grammaire française.
Le tome II est consacré quant à lui aux contenus grammaticaux des programmes des cycles 2 et 3. À la différence du premier volume, il propose une approche didactisée des contenus grammaticaux à enseigner aux élèves des cycles 2 et 3.
L’enseignement de la grammaire vise à développer chez les élèves des capacités métalinguistiques, c’est-à-dire une approche réflexive de la langue comme objet d’étude, en complément de l’approche instrumentale, qui consiste en l’usage fonctionnel de la langue dans diverses situations de la vie quotidienne. Prendre la langue pour objet d’étude, c’est être capable de parler de la langue, mais d’en parler d’une manière partageable donc d’une façon qui mobilise un langage commun, fondé sur la terminologie grammaticale.
Si l’enseignement de la grammaire à l’École n’a pas vocation à décrire l’ensemble du système de la langue française, il est important de définir clairement les zones de ce système qui sont accessibles à la description grammaticale. Ces zones sont celles des structures prototypiques. Toutes les entités et structures grammaticales (natures de mots ou de groupes de mots, fonctions, phrases, etc.) présentent des cas prototypiques, distincts de cas plus marginaux.
Un cas prototypique d’une catégorie est un membre clairement représentatif de la catégorie : une phrase verbale est un cas prototypique de la phrase (par opposition à la phrase averbale), un nom commun est plus prototypique de la catégorie du nom qu’un nom propre, un déterminant simple comme l’article les dans les élèves est plus représentatif de la catégorie « déterminant » qu’un déterminant complexe comme une foule de (une foule d’élèves sont arrivés), etc.
L'ouvrage vise à outiller les professeurs pour les aider à distinguer voire à produire des structures prototypiques adaptées et non erronées. Il a donc pour objectif d’aider les professeurs à développer leur capacité à identifier les structures de la langue française qui peuvent être analysées au moyen de la grammaire scolaire. L’enjeu est ici de leur permettre d’être en mesure d’exposer les élèves à ces structures de base préférentiellement et d’éviter de les confronter à des cas trop complexes, qui sont hors de portée de la grammaire scolaire et qui requièrent, pour leur description et leur analyse, des connaissances linguistiques plus approfondies.
Quand les élèves auront développé des capacités de catégorisation fiables sur les cas prototypiques, à l’école élémentaire et au collège, ils pourront, au lycée, approcher les cas plus complexes et développer leur esprit critique à l’égard de la catégorisation grammaticale elle-même, tout en acquérant peu à peu l’aptitude à percevoir les enjeux stylistiques des structures grammaticales.
L’enseignement de la grammaire doit donc s’appuyer sur les cas prototypiques, ce qui implique que les professeurs aient bien à l’esprit que les activités grammaticales, les exemples et les exercices doivent être adaptés à ce que la grammaire scolaire est en mesure d’analyser : c’est une certaine partie de la langue française qu’il convient de mobiliser pour l’enseignement de la grammaire.
La Grammaire du français, Tome II constitue un ouvrage de référence pour les professeurs. Il rappelle l’ensemble des notions à aborder aux cycles 2 et 3 et livre des recommandations utiles pour la conception d’exercices et d’activités grammaticales adaptés à la classe.
Reprise des cours / Année 2022/2023

Les cours de l'année universitaire 2022-2023 commenceront le 13 septembre pour les Licences et le 19 septembre pour les Masters.
Cours et séminaire 2022-2023
Séminaire "Linguistique théorique" 2022-2023
Introduction à la linguistique analogique
Le séminaire aura lieu comme l'année dernière année le lundi de 17h à 19h à la bibliothèque de l'UFR Langue française. Il commencera à partir du lundi 19 septembre.
Cours Licence et Master 2022-2023
Master LFA : "Linguistique française"
Le mardi de 8h à 10h / Salle F659.
Début des cours le 27 septembre
Licence 3 SDL : "Signification et théories linguistiques"
Le mardi de 11h à 13h / Amphi Champollion. Début des cours le 13 septembre.
Aspects langagiers contemporains de la cause animale
Iconicity in Language and Literature

L’indispensable inutilité de l’arbitraire du signe

Un langage déficient est-il le signe d’une intelligence déficiente ? Sur un paradoxe contemporain.

Phrase, paraphrase et analogie

Le vieux réaliste et le sénior nominaliste à l’épreuve de la « political correctness »

Dans un texte intitulé « Le politiquement correct : un nominalisme paradoxal », publié dans le volume collectif Langue commune et changements de norme (Branca-Rosoff et al., 2011), Dan Savatovsky s’intéressait au nominalisme comme concept épilinguistique et à ses rapports avec la catégorie du politiquement correct (« political correctness ») en proposant, à titre d’illustration, une analyse lexicographique en diachronie de l’opposition entre Juif et Israélite. Je propose de revenir sur cette analyse en examinant l’émergence de cette notion épilinguistique de nominalisme à partir d’un corpus de presse issu de Europresse, entre les années 1980 et 2020. Le nominalisme, comme catégorie épilinguistique, n’est évidemment pas sans rapport avec le concept philosophique de nominalisme, mais il s’en distingue cependant, par ses enjeux et son contenu. Il apparaîtra que cette catégorie est très majoritairement utilisée dans la presse située à droite de l’échiquier politique, pour accuser des adversaires de tenter de masquer la réalité par des mots ou, inversement, de créer une entité fictive en imposant l’usage de tel ou tel mot, ou encore d’accorder trop d’importance au choix de certaines dénominations. Cependant, personne ne semble échapper à ce nominalisme : ses plus virulents contempteurs attachent, par exemple, une importance stratégique au changement de dénomination de leur parti politique (de l’UMP aux Républicains, du Front National au Rassemblement Bleu-Marine), ce qui révèle une croyance typiquement nominaliste au « pouvoir magique des mots » (Savatovsky 2011). Cette question du rapport entre nominalisme et « political correctness » (il faut laisser cette expression dans sa langue, disait Derrida) sera examinée à partir de l’exemple non directement politique de l’installation dans le lexique du mot « sénior » comme concurrent de « vieux » pour désigner une classe d’âge dont il est d’ailleurs difficile de tracer les limites. En d’autres termes, on se demandera donc si les vieux sont vraiment la réalité du réaliste et les séniors le mirage du nominaliste.
Sur le concept linguistique d'image

Les métaphores et certaines expressions figées ou idiomatiques ont la propriété d’être perçues comme imagées ou « figurées ». La reconnaissance de cette propriété ne relève pas seulement d’une analyse métalinguistique mais aussi bien d’une appréhension ordinaire du langage, épilinguistique, dans la mesure où elle ne semble pas requérir d’apprentissage explicite mais procéder d’une analyse spontanée, naturellement acquise à partir d’un certain
degré de maîtrise de la langue. Pourtant, en dépit de son caractère trivial ou ordinaire, cette propriété que possèdent certaines expressions linguistiques d’être perçues comme si elles
étaient des images ou comme on percevrait des images, c’est-à-dire avec un effet d’image, présente un caractère foncièrement énigmatique : comment se fait-il que du langage soit pris
pour de l’image ? Ou, plus exactement, que des mots, dans certaines de leurs configurations, tendent à donner à celui qui les reçoit une impression d’image ? Car, en dépit de l’existence
d’une sphère graphique dans certaines langues, ou d’une dimension visuelle dans le cas des langues des signes, nos mots sont avant tout des entités sonores, non pas des entités visuelles.
Et, si l’on n’a cessé de revenir, dans la littérature si pléthorique consacrée aux figures, à l’analyse aristotélicienne de la métaphore, a-t-on vraiment pris la mesure de ce que signifie l’idée proposée dans la Rhétorique selon laquelle la métaphore « fait image » ou,
littéralement, « place sous les yeux » ? Cette communication consistera donc à explorer les contours d’un concept linguistique d’image, en faisant appel, dans le cadre d’une linguistique
théorique, d’une part à des apports issus des sciences cognitives et à d’autre part à des approches philosophiques de l'image.
Reprise des cours / Année 2021/2022

Les cours de l'année universitaire 2021-2022 commenceront le 14 septembre pour les Licences et le 20 septembre pour les Masters.
L'analogie en linguistique
Conférence à Dokuz Eylül Üniversitesi (Turquie)

Reprise des cours / Année 2020/2021

Les cours de l'année universitaire 2020-2021 commenceront le 14 septembre pour les Licences et le 21 septembre pour les Masters.
Faut-il accepter l'analogie "Holocauste animal" pour être (vraiment) antispéciste ?

L’antispécisme est un mouvement de pensée dans lequel s’inscrivent la plupart des militants de la cause animale et qui se définit par ce à quoi il s’oppose, le spécisme. Le mot « spécisme » est entré dans le Petit Robert en 2017 avec la définition suivante : « Idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces », et plus spécifiquement, qui conteste « la supériorité de l'être humain sur les animaux ». L’antispécisme est donc une idéologie qui, visant à la protection des animaux non-humains, s’appuie sur l’idée que la distinction entre animaux humains (les « hommes » au sens générique) et animaux non-humains doit être, sinon contestée, au moins relativisée et, en tout état de cause, ne doit pas être utilisée comme un argument justifiant l’exploitation des animaux (non-humains) par les hommes (ou « animaux humains »).
Certain(e)s militant(e)s antispécistes, dans leurs campagnes de sensibilisation, utilisent une analogie entre les abattoirs et les camps d’extermination de la seconde guerre mondiale, qui se traduit par l’emploi d’expressions comme « holocauste animal » ou « génocide animal », ou encore par des images véhiculant la même analogie. Par exemple, récemment, le 22 janvier 2020, une députée polonaise siégeant au Parlement européen, Sylwia Spurek, a partagé sur les réseaux sociaux un dessin qui montre des vaches marchant vers l’abattoir et portant des uniformes rayés ornés d’une étoile jaune comme ceux que les nazis imposaient aux Juifs dans les camps de concentration – ce qui n’a pas manqué de susciter des réactions contrastées, très favorables ou très défavorables. Les expressions « holocauste animal » ou « génocide animal », perçues comme choquantes par certains, sont donc défendues par beaucoup d’antispécistes comme ne faisant que décrire la réalité. Qui a raison ? Peut-on défendre l’emploi de ces expressions ou faut-il les condamner ? Servent-elles vraiment la cause qu’elles prétendent défendre ? Quelle est notre responsabilité à l’égard des mots que nous employons ? Toutes ces questions seront abordées selon un point de vue de linguiste, qui, certes, décrit ce qu’il observe dans les langues et les discours, mais dont les descriptions ne sont peut-être pas dépourvues de conséquences éthiques.
Pour citer cette ressource :
Philippe MONNERET, "Faut-il accepter l'analogie "Holocauste animal" pour être (vraiment) antispéciste ?", La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), juin 2020.
Symbolisme phonétique et transmodalité
Le symbolisme phonétique et la fonction iconique de l’analogie

La définition du symbolisme phonétique est fluctuante et parfois confuse. Après avoir
montré l’intérêt grandissant, mais qui demeure marginal, pour ce type de phénomène linguistique, nous proposons une analyse critique de la typologie très fréquemment citée de Hinton, Nichols et Ohala (1994), puis du traitement de la question dans la perspective de l’iconicité et, enfin, dans une perspective analogique. Une définition du prototype du symbolisme phonétique est proposée comme analogie phonosémantique, une analogie qui présente trois caractéristiques : elle implique un élément phonique, elle est binaire et hétérogène.
La question de l'interprétation en linguistique

Conférence à l'Université Complutense de Madrid, le 24 septembre 2019.
Reprise des cours / Année 2019/2020

Les cours de l'année universitaire 2019-2020 commenceront le 16 septembre pour les Licences et le 23 septembre pour les Master.
Enjeux contemporains de la linguistique théorique

Conférence dans le cadre du colloque "Décrire une langue : objectifs et méthodes". Paris 12-14 septembre 2019.
Iconicity as a Function of Analogy

Conférence dans le cadre du colloque "Iconicity in Language and Literature", 12, Lund (Suède), 3-5 mai 2019.
L'enseignement de la grammaire au collège

Conférence dans le cadre du séminaire « Enseignement de la langue », Paris, 27 mars 2019.
Functions of Analogy in Language

Conférence dans le cadre du séminaire de Linguistique d'Indiana University, Bloomington.
PPT de la conférence
Enseigner la grammaire à l'école primaire

Conférence à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation dans le cadre du séminaire des inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré, sur l'apport des sciences du langage pour l'enseignement de la grammaire à l'école primaire. Enregistrement vidéo de la conférence. Télécharger la vidéo.
Guillaume et Benveniste : deux aspects d'une anthropolinguistique

Introduction au numéro 2019/1 du Français Moderne, "Langue et condition humaine : Gustave Guillaume et Emile Benveniste".
Alpheratz. Grammaire du français inclusif

PRÉFACE
On entend dire que le français inclusif fait débat aujourd’hui. Qu’il soit le thème de propos de comptoir ou de bavardages médiatiques est certain, mais, pour qu’un débat existe, encore conviendrait-il qu’on en connaisse les termes. Or il est patent que la plupart des personnalités dotées de visibilité médiatique qui se sont exprimées à ce sujet n’ont aucunement eu besoin, pour se faire une opinion, de savoir ce qu’implique exactement le français inclusif : ni le type de formes linguistiques qu’il désigne, ni les objectifs qu’il poursuit, ni les conditions présumées de ces objectifs ne sont réellement pris en considération. Bien évidemment, si l’opinion est d’autant plus ferme et assurée qu’elle est ancrée sur l’ignorance ou la mauvaise foi, c’est qu’elle est faite d’avance. La Grammaire du français inclusif d’Alpheratz participe donc d’une saine exigence intellectuelle, consistant à observer et décrire les phénomènes avant de s’aventurer à formuler un jugement. Lire la suite de la préface
Reprise des cours / Année 2018-2019

Les cours de l'année universitaire 2018-2019 commenceront le 17 septembre pour les Licences et le Master LFA, le 24 septembre pour les autres Master.
Le programme d'une linguistique analogique (et ce qu'il peut apporter à la question de l'interprétation en linguistique)

Colloque international bisannuel de l'Association des Sciences du Langage 2017
"Les sciences du langage et la question de l’interprétation (aujourd’hui)"
Samedi 2 décembre 2017
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Programme et résumé des communications
La fonction figurative de l'analogie

Communication au colloque de Grenade : "Le langage figuré"
Colloque Symbolisme phonétique et correspondances transmodales
Université Paris-Sorbonne / 4 et 5 mai 2017

Les analogies impliquées de la traduction.

Communication au Congrès Mondial de Traductologie. Paris.
13 avril 2017. Université Paris-Nanterre
Tableau 2 : Alignement de dix traductions de la strophe 1 de The Raven
Programme du séminaire de linguistique théorique 2017

Cours et séminaire 2016-2017

Les enregistrements et présentations PPT des cours 2016-2017 sont mis en ligne chaque semaine dans la rubrique "Cours et séminaires". En Master, les cours commencent le lundi 3 octobre.
Langue et condition humaine : Gustave Guillaume et Emile Benveniste
Journée d’études organisée par Olivier Soutet et Philippe Monneret
Université Paris-Sorbonne / Salle des actes / 20 octobre 2016

La question des rapports entre Guillaume et Benveniste relève en premier lieu de l’histoire et de l’épistémologie des sciences du langage. Les deux linguistes, en dépit de la vingtaine d’années qui les sépare – Guillaume est né en 1883, Benveniste en 1902 –, ont développé leur production scientifique dans une période nettement caractérisée par le courant structuraliste, mais au sein duquel ils se sont inscrits d’une manière très singulière. Ces élèves de Meillet n’ont en effet jamais cessé de concevoir l’idée de structure, de système ou de formalisme en rapport avec la thématisation d’un sujet effectuant des opérations mentales chez Guillaume et constituant une instance énonciative chez Benveniste, avec la prise en considération du lien entre la langue et le monde extralinguistique, et

plus largement avec un intérêt central pour la dimension anthropologique de l’étude des langues – autant d’orientations notoirement opposées aux thèses majeures du structuralisme, au moins du structuralisme dit « généralisé ». Or, il semble évident que les orientations énonciatives, cognitives, référentialistes ou indexicales sont aujourd’hui beaucoup plus vivantes que celles qui se réclament d’une visée strictement structurale, définie par le primat de la théorie saussurienne de la valeur, et donc que les apports de Guillaume et de Benveniste semblent avoir survécu au courant dominant de leur époque précisément parce qu’ils n’en n’étaient que marginalement redevables, en raison notamment de la dimension anthropologique de la linguistique qu’ils pratiquaient.
L’orientation directrice de cette journée d’études sera donc d’examiner comment Guillaume et Benveniste incarnent cette appréhension anthropologique de l’étude des langues, selon laquelle l’analyse linguistique est orientée par des questions fondamentales pour l’être humain dans sa globalité, comme être vivant et comme être social. Ainsi, l’analyse linguistique du système verbo-temporel engage la question du temps humain. Ou encore, l’analyse de la personne grammaticale ou du rapport entre langue et discours affronte le problème de la nature du lien qu’établit le langage entre le sujet et le monde. Ces questions, parmi bien d’autres, ont été abordées d’une manière approfondie par les deux linguistes et il sera sans doute instructif de s’interroger sur ce qui les sépare et sur ce qu’ils ont en commun. Ont-ils chacun exploré, via les langues, des facettes différentes de l’humain mais dans une perspective d’ensemble commune ? Ou bien, plus radicalement, leurs conceptions respectives de ce qu’est l’homme dans son rapport au langage sont-elles foncièrement différentes, voire incompatibles ?
Dans une période où les impératifs techniques, économiques et industriels tendent à privilégier l’instrumentalisation des recherches linguistiques et l’obtention de résultats à court terme, on espère ainsi contribuer, à partir des œuvres de deux des plus grands linguistes français, à rappeler que les sciences du langage ont aussi des horizons lointains.
Programme
9h30 Accueil
9h45 Philippe Monneret
Introduction de la journée d’études
10h Irène Fenoglio
« L’anthropologie linguistique d’Emile Benveniste : une épistémologie de l’interprétance »
10h30 Charles de Lamberterie
« L'œuvre scientifique de Benveniste : au-delà de l'opposition artificielle entre théorie et pratique ».
11h Jean-Claude Coquet
« Le statut de la connaissance chez Guillaume et chez Benveniste »
11h30 Francis Tollis
« La dimension anthropologique / anthropogénétique de la linguistique de Gustave Guillaume ».
12h-14h Pause déjeuner
14h Franck Neveu
« Singulier/Pluriel - Du nombre chez Gustave Guillaume et chez Émile Benveniste ».
14h30 Marie-Christine Lala
« Les enjeux de la question des instances ».
15h Chloé Laplantine
« Gustave Guillaume, Emile Benveniste : quelle grammaire comparée ? »
15h30 Pause
16h Jeanne-Marie Barberis
« Langage et spatialité. Propositions pour une linguistique anthropologique »
16h30 André Jacob
« Temps et langage »
17h Discussion générale
18h Olivier Soutet
Bilan et clôture de la journée d’études
L'iconicité comme problème analogique

Le rôle majeur de l'analogie dans la cognition humaine ne cesse depuis les années 1980 de s'affirmer. Loin d'être limitée, dans la psychologie cognitive contemporaine, à un type de raisonnement (distingué de la déduction, voire de l'induction), l'analogie est désormais considérée comme un processus central, dont dépend notamment la catégorisation mentale, puisqu'une catégorie peut être définie comme un ensemble d'entités analogues selon un certain point de vue. L'innovation théorique que la linguistique analogique apporte à la question de l'iconicité consiste à établir un lien de causalité entre les structures iconiques dans les langues naturelles et les processus cognitifs de type analogique. D'une part l'analogie peut être définie, dans toute sa généralité - qu'il s'agisse d'analogie binaire ou proportionnelle - comme un processus impliquant des similarités ; d'autre part, les structures iconiques se décrivent usuellement comme manifestant une relation de similarité entre formes et contenus. Si l'humain, par son équipement cognitif, possède une grande aisance dans la perception ou la construction de relations analogiques entre les entités qu'il perçoit ou conçoit, il apparaît naturel que les langues présentent des traces de cette capacité fondamentale. On s'attache donc, en revenant notamment à la définition peirciennne de l'icône, à montrer en quoi l'iconicité est un cas de la linguistique analogique et à présenter les principaux enjeux théoriques d'une telle perspective. Lire "L'iconicité comme problème analogique"
Motivation et analogie. Enjeux de la similarité en sciences du langage

Le point de vue que j’adopte ici, pour traiter de la question de la motivation dans les langues, est celui d’une linguistique théorique, au sens guillaumien du terme. « Heur ou malheur, je suis né théoricien, disait Guillaume dans sa Leçon du 7 février 1957. Les attraits de la théorie sont pour moi qu’elle substitue à un voir, qui est celui des faits, un comprendre qui conduit à un voir supérieur, qui est de l’ordre de la compréhension » (Guillaume 1957 : 85). Rejetant les théories directement appuyées sur les faits ou les « hypothèses de travail », au motif « qu’on en peut construire un trop grand nombre pour les mêmes faits », il formule ainsi les conditions qui sont pour lui celles d’une bonne théorie : « La théorie, superlatif du comprendre, doit, pour m'agréer, satisfaire aux conditions formelles suivantes : aller à la rencontre des faits en position antagoniste, certes, mais prendre son départ non pas au fait mais à une exigence absolue, inévitable, et cheminer d'exigences absolues en exigences absolues jusqu'à la rencontre des faits. Le protagoniste de la théorie est alors une certaine exigence absolue, prise en considération au départ, et l'antagoniste est le fait, rencontré lorsque la théorie, comme dit l'Apôtre, "a couru sa course" » (ibid., p. 86) Ainsi, dans le cadre de la réflexion sur la motivation en linguistique qui fait l’objet de ce volume, j’admettrai que de nombreux faits de motivation dans diverses langues ont été décrits, et je me situerai en amont de ces faits pour tenter d’approcher cette exigence absolue à partir de laquelle les faits devront une nouvelle fois être rencontrés. Je n’apporterai donc ici aucune nouvelle donnée linguistique nouvelle, propre à illustrer le concept de motivation – on en trouvera de nombreux exemples dans le présent ouvrage –, mais un cadre théorique général, relevant aussi bien de la linguistique que de la philosophie du langage, dans lequel les faits de motivation trouveront leur place avec, je l’espère, une clarté qui leur donnera force d’évidence. Lire "Motivation et analogie. Enjeux de la similarité en sciences du langage"
Le singulier selon Gustave Guillaume

Parmi les tâches qui incombent aux linguistes s’inscrivant dans la mouvance guillaumienne, la clarification de la terminologie demeure une préoccupation essentielle. Bien que le Dictionnaire terminologique de la systématique du langage (Boone et Joly, 1996) ait marqué une avancée significative à cet égard, le foisonnement du métalangage guillaumien, son évolution ou ses variations au cours du temps, font que de nombreuses questions restent en suspens, non seulement pour qui s’intéresse, en historien, à la genèse de la théorie guillaumienne, mais aussi et surtout pour qui considère que la systématique du langage, nullement réductible à un objet d’histoire, reste une théorie féconde et exploitable pour les linguistes contemporains. Le caractère plus ou moins nécessaire de ce genre de clarification terminologique dépend bien entendu des questions de l’on se pose, ou qui émergent à une époque donnée et c’est sans doute pourquoi certains flottements demeurent invisibles tant que personne n’a éprouvé de gêne à leur endroit. Ainsi, il semble que les lecteurs de Guillaume n’ont guère été embarrassés, jusqu’à présent, par une variation terminologique qui touche pourtant un point crucial de la théorie guillaumienne, sa marque de fabrique la plus notoire : la tension « universel / singulier », qui est explicitement thématisée dès Temps et verbe (Guillaume, 1965 [1929]), et sera symbolisée à partir des années cinquante par le fameux « tenseur binaire ». Cette variation, perçue comme insignifiante, consiste en une alternance du couple « universel / singulier » avec le couple « général / particulier », qui conduit à s’interroger sur le sens des notions de singularité ou de particularité comme sur celui des notions d’universalité et de généralité. La question qui se pose alors n’est pas tant de savoir si les oppositions « universel / singulier » et « général / particulier » sont indifférenciées pour le linguiste Gustave Guillaume1, mais de déterminer le sens de chacun de ces termes pour en délimiter l’usage possible en systématique du langage, et plus généralement en linguistique, voire en philosophie du langage. On s’attachera ici uniquement à la distinction singulier / particulier, et plus précisément au sens du singulier dans le modèle guillaumien, sujet dont on verra qu’il couvre déjà une très large matière. Lire "Le singulier selon Gustave Guillaume"
L'analogie et l'énigme de l'expression

Il semble si étrange, aujourd’hui, de s’interroger sur le pouvoir intrinsèque du langage : sur le possible linguistique de l’émergence d’un sens neuf, sur le possible linguistique de la compréhension d’un sens qui fut inconcevable. Sans doute est-ce que la linguistique ne cesse – et ne cessera – d’être attirée vers ce qu’elle génère de technique, puisqu’elle est aussi une science du langage, et de se prêter à l’absorption dans de plus vastes domaines, des sciences cognitives à la sociologie, qui, assurément, permettent de justifier les faits linguistiques à partir d’un lieu qui leur est extérieur, mais en les réduisant dans le même mouvement à une activité humaine et sociale parmi d’autres activités humaines et sociales, et finalement comme un vecteur ou un révélateur de l’animal social humain pas plus significatif que sa propension à se nourrir, à habiter des lieux ou à entrer en relation avec autrui. Mais comment ne serait-il pas le plus significatif s’il désigne le geste de signifier ? Sans doute aussi est-ce que notre monde occidental a perdu une part de son habileté à mêler le signe et l’image, pour accentuer, au risque de la rendre irréversible, la séparation de l’information pure, circulation de signifiés affublés de signifiants indifférents, et l’iconicité brute, débauche de signifiants imaginaux dépourvus de signifiés assignables. Utiliser, pour dire cette sorte de rupture icono-sémiotique, le vieux langage de la linguistique saussurienne, ce concept de signe que l’on pourrait aussi bien, comme certains l’ont souhaité, exposer au musée de l’histoire des idées mortes, ce n’est pas s’interdire de dire quelque chose de plus que ce que la tradition a déposé dans ce mot. C’est justement tout le paradoxe ou plutôt toute l’énigme de l’expression que de permettre au langage de se dépasser sans sortir de lui-même, de ne pouvoir produire du neuf qu’avec de très anciennes matières, et de ne jamais signifier qu’en s’adossant à de l’insignifiant. Cette énigme de l’expression, nul n’a, je crois, aussi précisément tenté de la cerner que le Merleau-Ponty de la période dite « intermédiaire ». Lire "L'analogie et l'énigme de l'expression"
La théorie des univers de croyance à l'épreuve de la fiction

Dans un texte intitulé « The will to believe » (« La volonté de croire »), publié en 1896, le grand philosophe pragmatiste, William James, frère aîné du romancier (Henry), présente, au cours de son argumentation, un exemple destiné à illustrer le fait que nos croyances ne sont pas seulement des événements privés, enfermés dans les cerveaux des individus, mais qu’elles peuvent agir sur le réel. Imaginez, dit-il en substance, que, dans un train, vous soyez victime, comme l’ensemble des voyageurs, d’une petite bande de pillards menaçants, qui détrousse les uns et les autres sans que personne n’ose résister. Cette attitude craintive à l’égard des pillards repose sur la croyance dans le fait que personne ne viendra vous aider si votre acte de résistance vous met en danger. Mais si chaque passager possédait la croyance que tous les passagers chercheraient ensemble à maîtriser les pillards dans une telle situation, il est évident que l’acte de résistance serait votre réaction la plus spontanée. Plus généralement, il apparaît ainsi que les actes d’un individu appartenant à un groupe social quelconque sont déterminés, de près ou de loin, par les croyances communes à ce groupe social, et par conséquent que les croyances ont le pouvoir d’agir sur la réalité.
Cette anecdote vise à poser d’emblée que, dans le couple fiction et croyance auquel je m’intéresserai au cours de cette communication, la croyance est envisagée comme une représentation mentale effective, au sens d’un événement ou d’un fait mental réel produit par le système cognitif humain. Ce point de départ indique que l’approche de la fiction que je vais développer s’inscrit dans un cadre apparenté à celui des sciences cognitives.
Plus précisément, l’hypothèse que je propose concerne le processus de lecture, que je définirai comme une relation entre l’univers de croyance du lecteur et les univers de croyance déposés dans un texte par un auteur. Je précise immédiatement que, s’il me paraît incontestable que l’être humain nommé auteur est la cause efficiente des univers de croyance textuels, et qu’en tant que tel, il est susceptible d’affecter ces derniers, la lecture telle que je la conçois n’établit pas de relation directe entre l’univers de croyance du lecteur et l’univers de croyance de l’auteur. Autre précision élémentaire : cette relation est orientée. Il va de soi en effet que si l’univers de croyance d’un lecteur peut être affecté par des univers de croyance textuels, les univers de croyance textuels ne sont pas susceptibles d’être altérés par l’univers de croyance du lecteur.
L'iconicité linguistique chez Bachelard

La poétique de la rêverie se développe chez Bachelard indépendamment de toute sollicitation du champ couvert par les sciences du langage. Non seulement celui-ci se présente comme un « ignorant en linguistique » – ignorance qui, loin d’être négative, semble constituer une condition nécessaire d’accès à la rêverie poétique – mais en outre, les questions de langue qui intéressent Bachelard, et qui portent essentiellement sur le genre grammatical des substantifs, sont selon lui négligées par les linguistes. Il n’est guère surprenant qu’un philosophe, dans les années 1960, définisse son appréhension du langage hors du domaine de la linguistique : le repoussoir d’une discipline qui se rêve science pilote à l’apogée de sa période structuraliste, la menace hégémonique du linguistic turn, qui tend à épuiser toute investigation philosophique dans une interrogation préalable sur les potentialités de la langue, deux bonnes raisons sans doute pour les philosophies du langage de cette époque de se définir dans le cadre d’une philosophie conçue comme autonome, notamment à l’égard des sciences humaines auxquelles la linguistique appartient. Cependant, sans chercher absolument à réconcilier Bachelard avec une discipline dont il s’est fort bien passé, nous voudrions montrer (i) d’une part que la conception de la langue sur laquelle est fondée la Poétique de la rêverie s’inscrit dans une problématique authentiquement linguistique, celle de l’iconicité ; (ii) d’autre part et indépendamment de cette problématique, que la question du genre grammatical, telle qu’elle est posée dans la Poétique de la rêverie n’a pas été négligée par les linguistes autant que le prétend Bachelard.
Iconicité et analogie

On trouvera dans ce texte quelques réflexions visant en premier lieu à clarifier le concept d’iconicité, à définir ou redéfinir son extension, et ceci notamment dans sa relation avec la notion d’analogie. Il apparaît en effet assez rapidement à qui s’intéresse à toute question relative à la motivation du signe, que les définitions et typologies héritées aussi bien des sémiotiques générales que des linguistiques d’inspiration saussurienne ne permettent guère de saisir avec pertinence les objets dessinés par ce type de questionnement. Interroger le concept d’iconicité, c’est bien entendu interroger le concept d’image. D’ailleurs, si le colloque au cours duquel ce texte a été présenté s’intitulait « Le mot comme signe et comme image », c’est bien que l’on espère que l’image peut ouvrir sur la langue des perspectives que l’appareil conceptuel habituel de la linguistique ne permet pas d’envisager. Ce qui suppose, sauf à tenir un discours fondamentalement métaphorique, que l’image soit définie indépendamment de la visibilité. Quant à l’analogie, dont on croit souvent avoir tout dit en la définissant comme une structure de quatrième proportionnelle, il conviendrait de s’interroger non seulement sur la nature de la relation qui constitue le tertium comparationis de ce type de structure, mais aussi sur l’instance qui perçoit ou construit une telle relation, sans oublier que la distinction entre analogie et ressemblance n’est peut-être pas aussi claire qu’il paraît de prime abord. On se souviendra que Gérard Genette faisait reposer l’essentiel de sa réfutation des mimologistes sur la confusion commise par ces derniers entre analogie et ressemblance (ou plus précisément sur une sur-interprétation de l’analogie en ressemblance). Mais est-il si évident que la première ne se confonde jamais avec la seconde ? Si la ressemblance – ou plutôt la semblance – est elle même fondée sur une analogie, comment distinguer les cas où la relation analogique tolère une extension en semblance des cas où elle ne l’admet pas ?
 Philippe Monneret
Philippe Monneret